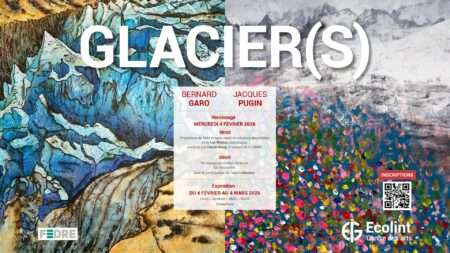Dans sa dernière newsletter, qu’il diffuse sur Substack, Sévérin Duc retrace l’expérience de Warren Buffett avec Berkshire Hathaway, une usine textile en difficulté dans les années 1960 à une nouvelle holding performante dans le secteur financier, pour en tirer une leçon applicable aux régions alpines et aux stations touristiques d’hiver.
Séverin Duc suit depuis longtemps la question de l’évolution du tourisme de montagne, notamment en France, à la lumière du changement climatique, de l’économie et de la société. Il est l’une des voix d’un débat qui est certainement plus vif dans les Alpes françaises qu’en Italie ou en Suisse.
En Italie, le poids des stations d’hiver est moindre et l’attention reste portée sur les montagnes qui se dépeuplent, comme le montre la recherche Rapporto montagne Italia de l’Union des communes de montagne italiennes. En Suisse, l’adaptation du modèle technique et commercial au changement climatique semble prévaloir, dans l’observation actuelle de l’augmentation des revenus des grandes stations.
Cependant, d’autres voix se font entendre en France, comme celle de Laurent Reynaud, délégué général des Domaines Skiables de France, qui s’est exprimé le 3 novembre lors d’une table ronde sur le même sujet à Grenoble Ecole de Management.
Reynaud affirme par exemple, face à des positions plus tranchées sur l’abandon des politiques de ski, que le modèle demeure et qu’il faut le faire évoluer. Les occasions de débattre sont variées. Au salon international du livre de Passy lui-même, une session a été consacrée à ce sujet, à laquelle a participé une autre voix importante de ce débat, celle de Guillaume Desmurs.
Mais venons-en au raisonnement de Séverin Duc dans sa lettre d’information, sur Warren Buffet, le textile et l’avenir des Alpes.
Le cas de Warren Buffet dans le textile
Buffett rachète Berkshire Hathaway en 1965 et se trouve immédiatement confronté à une industrie en déclin structurel. Malgré le dévouement des ouvriers et la qualité du management, la concurrence mondiale et les marges de plus en plus faibles rendent tout investissement dans le textile de plus en plus inefficace.
En 1967, Buffett cesse de réinvestir dans le textile et achète une compagnie d’assurance, National Indemnity, ouvrant ainsi la voie à une diversification radicale avec d’autres acquisitions. Ce n’est qu’en 1985 qu’il a finalement décidé de fermer l’entreprise textile, reconnaissant que les ressources dépensées pour « combler les lacunes » étaient improductives par rapport à un changement de direction.
Duc souligne comment Buffett a agi avec prudence et responsabilité sociale (en reconnaissant le rôle de ses entreprises textiles dans les communautés locales, pour l’emploi et le développement) mais aussi avec la lucidité nécessaire pour interrompre un modèle économique qui n’était plus soutenable et chercher une seconde voie.
Les Alpes et la crise du tourisme d’hiver
Duc transpose cette réflexion aux Alpes contemporaines. Les stations de ski, en particulier celles de moyenne altitude, se trouvent dans une situation similaire : un modèle de développement basé sur la neige et des infrastructures mécanisées montrant des signes évidents de crise, renforcé par le changement climatique. Les investissements dans les canons à neige ou dans un marketing différencié semblent rationnels lorsqu’ils sont considérés individuellement, mais ensemble, ils deviennent contre-productifs, générant des rendements décroissants et immobilisant les ressources financières.
Comme dans le textile, les stratégies de survie ne suffisent plus. Continuer à investir dans le même modèle revient à renforcer l’inefficacité. Pour éviter un effondrement futur, Duc soutient que les communautés alpines doivent choisir une stratégie d’investissement dans la valeur territoriale, c’est-à-dire une réallocation intelligente du capital vers les entreprises de la région, sur des chaînes à identifier et à construire, par exemple sur l’innovation et la fabrication, les chaînes d’approvisionnement durables et la production sur mesure, tout comme Buffett l’a fait en se diversifiant dans l’assurance.
Une question d’identité et de stratégie
Le problème n’est cependant pas seulement économique. Pour de nombreuses communautés alpines, les stations de ski représentent une identité partagée, une mémoire historique et une économie circulaire impliquant des familles, des métiers et des territoires. Tout comme Buffett a longtemps hésité par respect pour ses travailleurs et la communauté locale, les Alpes peinent elles aussi à rompre avec un système qui a garanti la prospérité et la cohésion sociale.
Mais, selon Duc, l’audace est aujourd’hui une forme de prise en charge collective. Changer de cap ne signifie pas fermer des stations, mais créer un « deuxième bateau » vers lequel tendre.
L’heure n’est pas à la nostalgie, mais à la construction de nouveaux projets capables d’assurer la résilience économique et climatique. Le vrai risque, prévient M. Duc, n’est pas d’abandonner le modèle touristique classique, mais de ne pas avoir de plan B.
LIRE AUSSI : « FUTUReALPS », l’avenir de la « montagne 4.0 » se construit en Vallée d’Aoste