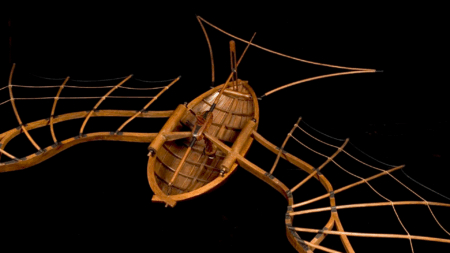La Turbie est un joli village sur les hauteurs de la Côte d’Azur, entre Nice et Monaco, non loin de la frontière italienne. Les cigales chantent au milieu des pins, le village se serre autour de son église.
A presque 500 mètres d’altitude, en position dominante sur la mer Méditerranée, ce site a revêtu au cours des siècles une importance parfois oubliée. Et pourtant, trois faits marquants ont intégré La Turbie dans le grand livre de l’Histoire. Partons à la découverte d’un village surprenant.
La Turbie, ville romaine
Aujourd’hui on parcourt l’autoroute pour passer d’Italie en France ou vice-versa et parfois lorsqu’on a le temps on longe la côte au niveau de la mer. Mais les Romains, eux, avaient construit la route sur les hauteurs : c’était la Via Julia Augusta, qui reliait Plaisance, dans le Nord de l’Italie au fleuve Var. Cette route permettait de poursuivre le tracé de la Via Aurelia, qui de Rome s’arrêtait alors à Vado Ligure. Cette route passait par La Turbie. Elle devenait de fait, la voie principale pour réunir Rome à l’Hispanie, en reliant la Gaule cisalpine à la Gaule transalpine. Avant cela, il fallait passer par la Vallée de Suse et le col de Montgenèvre.
Mais pourquoi avoir attendu autant pour continuer ce tracé presque côtier ?
La Via Julia Augusta a pu être construite uniquement après la pacification des tribus celto-ligures qui habitaient les Alpes Maritimes en l’an 14 avant Jésus-Christ. Elle porte le nom de l’Empereur Auguste, grand conquérant et grand pacificateur des peuples alpins qui a permis la traversée des Alpes en toute sécurité à ses troupes.
En honneur à cette conquête, le Trophée des Alpes fut construit, quelques années après, vers l’an 6 avant Jésus-Christ, sur le point le plus élevé du tracé, au col de La Turbie. C’est ce monument tout blanc dont on admire encore les ruines aujourd’hui. Sa valeur historique est très importante car il marque la frontière entre la Gaule cisalpine et la Gaule transalpine. On dirait aujourd’hui que c’était la borne frontière entre l’Italie et la France.
En échange de cette pacification, les peuples vaincus reçurent une cité, celle de Cemenelum, en face de Nikaïa, l’ancien comptoir grec. Aujourd’hui, Cemenelum s’appelle Cimiez, et c’est un quartier de Nice dans lequel on peut admirer des vestiges romains (notamment un amphithéâtre). Et bien sûr Nice est le nouveau nom de Nikaïa.
Le trophée des Alpes de la Turbie, un monument impressionnant

Aujourd’hui il ne reste plus grand-chose du Trophée des Alpes, mais on peut encore en saisir la taille imposante.
En effet, d’après les recherches et les reconstitutions archéologiques, le monument devait avoir une apparence grandiose. Il a dû être construit en partie en utilisant les matériaux locaux extraits dans les carrières de La Turbie. Il reposait sur une base quadrangulaire monumentale : le trophée reposait sur un large soubassement mesurant environ 35 mètres de côté et 12 mètres de haut. Cette base contenait des inscriptions dédiées à Auguste, détaillant les peuples alpins vaincus.
Il présentait un cylindre central imposant : au sommet du soubassement s’élevait un corps cylindrique d’environ 24 mètres de haut. Ce cylindre était orné de colonnes corinthiennes, disposées en cercle, surmontées d’un entablement décoré.
Le sommet du trophée aurait été couronné par une statue colossale de l’empereur Auguste, mesurant environ 6 mètres de haut. Elle symbolisait la puissance de Rome et l’unification des territoires alpins.
Et très probablement, il y avait probablement des statues et des bas-reliefs représentant les peuples vaincus, les symboles de la Pax Romana et des inscriptions commémoratives.
Au total, le monument devait atteindre environ 49 mètres de hauteur. Le Trophée des Alpes était non seulement un symbole militaire et politique, mais aussi un point de repère visible depuis la mer, marquant l’entrée de l’Italie romaine et l’importance stratégique de la Via Julia Augusta.
Aujourd’hui, seuls subsistent la base et une partie du cylindre, le reste ayant été en grande partie démonté au Moyen Âge pour réutiliser les pierres dans des constructions locales. Et nous allons voir ce qui s’est passé.
Mais qui a détruit le Trophée des Alpes ?
Même si on sait que le Trophée des Alpes a servi de forteresse pour protéger le village de La Turbie qui se construisait petit à petit au Moyen Âge, on a la certitude que ce n’est pas sous les attaques ennemies pendant une bataille que le monument a été détruit.
C’est plus tard. En 1705. La guerre bat son plein encore une fois entre la France et la Savoie. Et Louis XIV ordonne la destruction de tous les forts, forteresses et assimilés de la région possédée par la Maison de Savoie et occupée par les Français.
C’est aussi ainsi la fin du Trophée des Alpes qui protégeait La Turbie. Détruit par explosion, ses pierres furent utilisées pour construire des maisons et des monuments, et même la très belle et baroque église Saint-Michel, au centre du village.

Mais pourquoi La Turbie appartenait-elle à la Maison de Savoie ?
Depuis la « dédition de Nice », les provinces orientales de la Provence sont passés sous domination savoyarde.
La dédition de Nice en 1388 s’inscrit dans un contexte de troubles en Provence après la mort de la reine Jeanne Iᵉʳ de Naples (1382), marquée par une guerre de succession opposant Louis II d’Anjou, neveu du Roi de France et fils de Louis Iᵉʳ d’Anjou, Comte de Provence et héritier désigné par Jeanne Iᵉʳ , mort avant les faits et Charles de Duras, qui finalement deviendra Roi de Naples.
Nice faisait partie du Comté de Provence, sous domination du Royaume de Naples, et les rivalités entre les deux camps créaient instabilité et faiblesse de la gouvernance. Ceci poussa les communautés niçoises, soucieuses de stabilité et de protection, à se tourner vers la Maison de Savoie.
Pendant cette même période d’instabilité et de tension entre Comté de Provence et Royaume de Naples, la Maison de Savoie avait déjà occupé, pacifié et récupéré les territoires du Sud du Piémont, notamment la région de Cuneo.
Cette expansion vers le sud attira l’attention des Niçois, qui y virent une possibilité d’intégrer un Duché stable en pleine expansion.
Mais c’est aussi ainsi que La Turbie et le territoire qui constitue aujourd’hui celui des Alpes Maritimes eurent à faire face aux tensions et aux guerres frontalières franco-savoyardes pendant près de cinq siècles, jusqu’en 1860.
Dans ce territoire, il existe une infime parcelle de terre qui a également demandé la protection de la Maison de Savoie, pendant son histoire : c’est la Principauté de Monaco.
La Turbie, à l’origine de l’histoire de Monaco
Pendant la période de la domination romaine, La Turbie et le site de Monaco étaient très connectés. La ville romaine et la garnison se trouvaient à l’abri, sur le plateau, en hauteur, et le port se trouvait en bas, sur le site fondé par les Grecs.
Bien plus tard, en 1191, l’Empereur Romain Germanique Henri IV décide de démanteler la seigneurie de La Turbie. Il donne le territoire du rocher en bord de mer aux seigneurs de Gênes.
Voilà pourquoi on peut dire que La Turbie a donné naissance à Monaco ! Et la falaise entre les deux sites devient, de fait, une frontière.
La forteresse sera construite en 1215, à partir de 1297 les Grimaldi en prennent possession. La Turbie reste dans le giron et l’histoire des Comtes de Provence. Par contre Monaco se développe sous la domination directe des Grimaldi et la protection des mêmes Comtes de Provence. Ils étendent même leur territoire vers Roquebrune et Menton, territoires qui seront gardés jusqu’en 1860. Au XVème siècle Monaco réussit son action diplomatique en se mettant sous la protection du Roi de France et de la Maison de Savoie par une habile manœuvre.
Mais les relations, parfois tumultueuses entre La Turbie et Monaco se sont poursuivies au fil des siècles. En 1705, pendant la guerre franco-savoyarde, Louis XIV accorda même la possession de la seigneurie de La Turbie au Prince de Monaco qui souhaitait récupérer ce site stratégique. Cette situation dura jusqu’au traité d’Utrecht, qui permit à la Maison de Savoie de récupérer ses terres.
La France affaiblie ne pouvant plus défendre la principauté, celle-ci fut finalement obligée, par la Maison de Savoie, de renoncer à récupérer le territoire de La Turbie en échange du maintien de ses possessions sur Roquebrune et Menton. Un traité fixa les frontières définitives en 1760. C’est ainsi que La Turbie resta dans le giron savoyard, et devint ensuite française en 1860.
Lorsque La Turbie devint française, les liens continuèrent avec la Principauté, ne serait-ce que pour continuer à importer la pierre calcaire blanche issue des carrières de La Turbie. Celle-là même qui avait été utilisée par les romains pour construire le Trophée des Alpes.
Des liens renforcés car en ces temps, et jusqu’en 1883, il n’y avait qu’une route, la Grande Corniche, ancienne Via Julia Augusta. Elle longeait la côte et était utilisée pour descendre sur le rocher et cette route passait par la Turbie. Il y eut même un chemin de fer à crémaillère qui réunit La Turbie à Monaco pendant quarante ans entre 1894 et 1932. Il permettait à La Turbie de bénéficier de l’arrivée du chemin de fer qui désenclavait Monaco en 1868. C’était le début du tourisme avec des trains provenant de Paris. Les échanges frontaliers continuaient d’exister.

Monaco et La Turbie aujourd’hui
Aujourd’hui, de nombreuses actions conjointes ont été menée entre la Principauté de Monaco, dont le territoire est restreint et la commune de La Turbie à la superficie plus vaste. Par exemple, le centre d’entraînement de l’équipe de football de l’AS Monaco, qui joue dans le championnat français se trouve sur la commune de la Turbie. La principauté a également financé la piscine municipale et d’autres infrastructures, comme la nouvelle bretelle d’autoroute de Beauregard. Des relations financières avaient commencé déjà au XXème siècle. En effet, le Prince de Monaco contribua à la restauration du Trophée des Alpes de La Turbie et offrit l’horloge qui trône sur le fronton de la mairie.
Des relations très étroites malgré plus de huit siècles de séparation administrative pour ces deux territoires géographiquement très liés.
C’est ainsi que La Turbie, un simple col traversé par une route romaine s’est retrouvé plusieurs fois à la frontière d’états différents. Elle a profité de sa situation pour s’agrandir ou bénéficier de partenariats mais aussi en subissant des conséquences néfastes comme des partitions et des destructions. Aujourd’hui, La Turbie est une belle étape touristique au panorama extraordinaire, au pied des Alpes, en face de la mer Méditerranée.
LIRE AUSSI: La Sacra di San Michele, monument symbole du Piémont
DÉCOUVREZ TOUS LES REPORTAGES DE … NOS ALPES À LA DÉCOUVERTE !