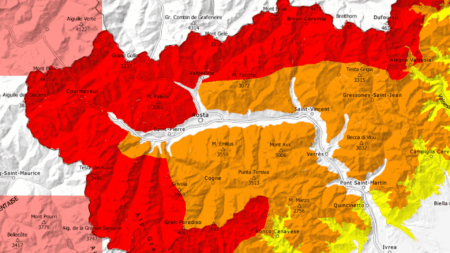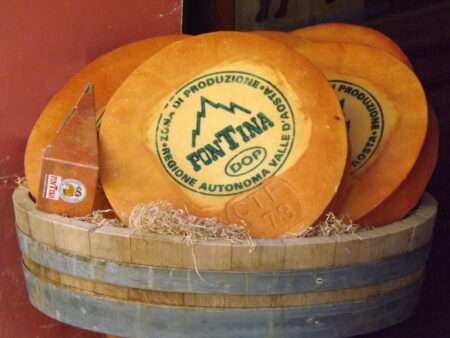***
Le Fort de Bard est sponsor et soutient la rubrique Nos Alpes à la Découverte

***
A Chambéry, on peut compter sur les doigts d’une main les statues importantes, celles qui peuvent nous raconter l’histoire de la ville. Pourtant, on passe à côté de certaines d’entre elles sans même lever les yeux. On ne les remarque pas et pourtant elles sont remarquables.
Elles embellissent les lieux, certes, mais elles envoient aussi des messages silencieux aux passants qui ont l’habitude de les côtoyer sans les voir.
Quelques touristes les prennent en photo, souvent sans connaître l’histoire des personnages représentés qui ont fait l’histoire de Chambéry.
Et si on se promenait à notre tour dans la vieille ville de Chambéry à la découverte des cinq statues qui en racontent l’histoire ?
La statue d’Antoine Favre sur la place du Palais de Justice de Chambéry

Antoine Favre était un juriste et c’est justement devant le Palais de justice de Chambéry que trône sa statue. C’est le premier édifice historique que l’on rencontre lorsqu’on arrive à pied depuis la gare en direction du centre-ville. Sa belle façade néoclassique typique de l’architecture piémontaise du XIXème siècle lui donne un aspect sobre et noble à la fois.
Quel étrange destin pour ce bâtiment qui lorsqu’il a été décidé de le construire en 1848, devait faire appliquer la justice du Royaume de Sardaigne sur la terre de Savoie. Depuis le lancement des travaux par le roi Victor Emmanuel II et la reine Adélaïde, jusqu’en 1860 il a été utilisé au fil de l’avancement des travaux mais jamais réellement inauguré. Et il ne l’aura jamais été, car le premier événement dont il a été témoin est la ratification du plébiscite qui approuva la cession de la Savoie à la France en 1860.
Qu’a donc dû en penser Antoine Favre, ou plutôt sa statue ? Originaire de la Bresse, autrefois territoire de la Maison de Savoie, Favre fait des études d’avocat à Turin, dans les années 1570, dans la toute nouvelle capitale du Duché de Savoie. Si la capitale a été déplacée, c’est aussi car le Duc Emmanuel Philibert trouvait que Chambéry était une place trop difficile à défendre face aux incursions françaises.
Les institutions de Savoie
Cependant, afin de maintenir un lien juridique étroit avec ses anciennes terres tout en reconnaissant une certaine autonomie de décision, le Duc, décida d’instituer une cour de justice, appelée Sénat de Savoie, dès 1559. Antoine Favre, un des meilleurs juristes du Duché y fut nommé en 1587, et en devint le Président en 1608 ou en 1610 selon les sources. Fort de son aptitude de diplomate, il devint même Gouverneur Général du Duché de Savoie.
C’est donc la statue d’une des figures les plus importantes de l’âge d’or du Duché de Savoie, au XVIIème siècle, qui trône devant le Palais de Justice de Chambéry.
Il est également le co-créateur, à Annecy, de l’Académie Florimontane, société savante, qui encourageait la philosophie, les lettres et les sciences. C’est la plus vieille institution francophone de ce type, puisque l’Académie Française n’a été créée que 29 ans plus tard. C’est grâce à l’institution dont elle fut l’héritage, l’Académie de Savoie, qui resta en fonctionnement après l’annexion, au temps de Napoléon III, et à la volonté de la ville de Chambéry que l’hommage fut rendu à Antoine Favre sous la forme d’une statue en 1865.
La statue de la Sasson, proclamation d’une Savoie française

A quelques dizaines de mètres du Palais de Justice, à une des extrémités de la moderne Avenue des Ducs de Savoie et du bien plus agréable Boulevard de la Colonne, se trouve la statue assez anonyme d’une femme tenant un drapeau entre ses mains : la Sasson. Elle fut érigée en souvenir, non pas de l’annexion de la Savoie à la France en 1860, mais de celle de 1792. La France révolutionnaire entre en Savoie en septembre 1792, chasse l’armée Sarde et occupe la Savoie jusqu’à la chute de Napoléon en 1815.
C’est une longue parenthèse française pendant laquelle le traitement réservé au clergé et la conscription obligatoire ont refroidi les partisans du changement de régime qui avaient pourtant souhaité et facilité l’annexion. C’est ainsi que les positions des plus conservateurs qui espéraient le retour dans le giron de la Maison de Savoie ont été renforcées. Joseph de Maistre, dont nous évoquerons la statue dans le prochain paragraphe est un de ceux-ci.
La “Grosse Françoise”
Revenons à la Sasson. C’est donc pour célébrer le centenaire de cette première annexion que les autorités françaises ont décidé d’ériger la statue d’une femme du peuple, d’une mère de la nouvelle nation, en 1892, trente ans après l’annexion définitive.
Pas très esthétique, elle fut ironiquement surnommée par ce nom que l’on pourrait traduire la « Grosse Françoise » par les Savoyards opposants à l’annexion.
Mais si elle est devenue aujourd’hui un symbole de résistance et de révolte populaire, ceci n’est nullement liée aux relations entre la France et la Savoie. En 1942 la statue est déboulonnée pour être fondue dans le cadre de l’effort de guerre. Elle a été retrouvée intacte mais décapitée dans la gare de Hambourg, en Allemagne en 1950 et rendue à la ville de Chambéry. Complétée par une nouvelle tête en 1982, elle a repris sa place dans la ville, à sa place actuelle, à l’extrémité du Boulevard de la Colonne.
Mais avant de parcourir ce boulevard et d’aller découvrir la fontaine monumentale et très célèbre qui s’y trove, faisons un détour par la vieille ville médiévale jusqu’au Château des Ducs de Savoie.
La statue de Joseph de Maistre devant le Château des Ducs de Savoie

Avant d’arriver devant la statue de Joseph de Maistre devant le château des Ducs de Savoie, il faut prendre le temps de parcourir les ruelles du Vieux Chambéry. La rue Saint Antoine coupe perpendiculairement la rue Favre (encore lui !) et conduit les passants sur les Halles de Chambéry. C’est la place du marché. On peut faire un détour pour admirer le joli Hôtel de Ville avant de rentrer dans la très étroite rue du Sénat de Savoie. En tournant sur la droite on prend rue de la juiverie et on finit par tomber sur les murs du château.
On aperçoit la statue devant les escaliers qui montent vers le château. Surprise, sur le piédestal de la statue, il y a deux frères : Joseph et Xavier de Maistre.
Xavier s’est engagé tôt dans l’armée sarde, dès 1784. Mais voilà que la révolution fait rage en France et que les Français entrent en Savoie en 1792. Les régiments sardes sont obligés de se replier au-delà des Alpes et Xavier de Maistre finit par se retrouver à Aoste. Il y habite cinq ans. Une rue lui est dédiée, et sa maison fut épargnée lors de la construction de la Rue du Conseil des Commis. Ensuite il part combattre pour l’armée Russe et s’installe enfin à Saint Petersbourg, où il retrouve son frère Joseph de Maistre, représentant du Roi de Sardaigne en Russie en 1803. Xavier de Maistre mourra en Russie en 1852.
Joseph de Maistre
Joseph de Maistre a une trajectoire plus politique. Membre du Sénat de Savoie au moment de l’occupation française de 1792, il résiste d’abord politiquement, ensuite diplomatiquement depuis Lausanne. Proche du Roi, il occupe le poste de régent de la Chancellerie avant d’être nommé ministre plénipotentiaire en Russie auprès du Tsar.
De retour à Turin en 1817, au moment où le Royaume Sarde reprend possession de ses terres, son conservatisme et sa loyauté à son Etat est salué également dans la France de la Restauration. Il est élu à l’Académie des Sciences, belles-lettres et arts de Savoie, celle-là même qui fut créée par Antoine Favre deux siècles plus tôt.
Cette même Académie fut à l’origine de la statue de frères de Maistre qui fut édifiée en 1899, lui qui a tant fait pour que le Royaume Sarde, et donc la Savoie retrouve sa dignité.
Même si les idées politiques de Joseph de Maistre se sont teintées de conservatisme au moment où les Français sont rentrés en Savoie, il était plutôt en faveur de l’évolution des idées plus équitables qui parcouraient la France prérévolutionnaire. Et en cela, il était ouvert aux idées développées par les philosophes de l’époque des Lumières.
Un des grands philosophes qui ont contribué à la propagation des idées de justice sociale et d’égalité est Jean-Jacques Rousseau. Il a aussi une statue à Chambéry.
Jean-Jacques Rousseau, l’hôte le plus prestigieux de Chambéry
Pour voir la statue de Jean Jacques Rousseau, il faut traverser la ville jusqu’à la petite colline du parc du Clos Savoiroux., de l’autre côté de la voie de chemin de fer. Cette statue qui représente le philosophe dans une de ses promenades solitaires, scène inspirée du titre d’un de ses ouvrages, a été érigée en 1910, pour le cinquantenaire du rattachement de la Savoie à la France.
Symbole politique, la statue se trouve sur une colline qui fait face à la vieille ville dominée par son château des Ducs de Savoie et son histoire féodale, dans un quartier qui représente la modernité et les temps nouveaux et à une altitude supérieure à celle de l’emplacement de la statue des frères de Maistre. La pensée progressiste et sociale proposée par Rousseau se veut ainsi dominer la tradition et le conservatisme monarchiste de Joseph de Maistre.

Mais pourquoi une statue de Jean-Jacques Rousseau à Chambéry ?
En 1728, après avoir quitté Genève, à l’âge de 16 ans, il est accueilli en Savoie par Madame de Warens, une figure influente qui joue un rôle déterminant dans sa vie. Leur relation, tant personnelle qu’intellectuelle, s’intensifie à Chambéry, où elle lui procure un emploi et l’introduit à la vie culturelle locale. Malgré la modestie de son logement et la monotonie de son travail au cadastre, Rousseau s’épanouit en explorant la musique, l’arithmétique, et le dessin, et organise des concerts pour partager sa passion musicale. Les Charmettes, leur résidence estivale, deviendront un lieu emblématique de son séjour en Savoie, évoqué avec tendresse dans Les Confessions. Chambéry incarne pour Rousseau la douceur de vivre et marque le début de son parcours intellectuel et artistique.

On peut encore visiter Les Charmettes, à la sortie de la ville au Sud de Chambéry, à deux kilomètres du centre-ville. On y découvre l’univers dans lequel Rousseau a construit sa pensée.
Revenons vers le centre-ville, à mi-chemin entre le passé et la modernité, entre l’histoire de Savoie et celle de la République Française. Retrouvons-nous à la Fontaine des Eléphants.
La Fontaine des Eléphants, symbole de Chambéry
A Chambéry, on voit des éléphants partout. Au sol le long des parcours fléchés touristiques, sur les cartes postales vendues dans les bureaux de tabac et au stade de hockey sur glace lorsqu’on supporte l’équipe locale des Eléphants de Chambéry.
Eléphants, Alpes… on pourrait faire un lien avec Hannibal ? Non pas du tout. Pour comprendre, il faut se rendre sur le Boulevard de la Colonne et admirer la grande fontaine qui s’y trouve.
Une colonne surmontée d’une statue du Comte de Boigne repose sur un socle composé de quatre éléphants dont on ne voit que les pattes antérieures et la tête. C’est d’ailleurs pour cela qu’à Chambéry, on les appelle les « quatre sans cul ». Par leurs trompes, jaillit l’eau de la fontaine.
Qui est le Comte de Boigne ?

Benoît Leborgne, connu sous le nom de comte de Boigne, est né le 8 mars 1751 à Chambéry, en Savoie. Aujourd’hui, on dirait que c’est un aventurier, un mercenaire et un mécène. Il eut une vie extraordinaire.
Issu d’une famille de commerçants, il s’engagea en 1768 dans un régiment irlandais au service de la France, où il acquit une formation militaire et apprit l’anglais. En effet il avait eu un différend avec un soldat sarde et ne put servir l’armée de son pays.
Après plusieurs campagnes en Europe et dans l’océan Indien, il quitta l’armée en 1773. Attiré par l’aventure, il se rendit en Russie et participa à la guerre russo-turque, mais fut fait prisonnier à Constantinople. Libéré grâce à l’intervention de l’ambassade britannique, dont il avait été ennemi mais qui lui reconnaissant ses talents d’officier, il rejoignit l’Inde en 1778.
À Madras, il intégra le 6ᵉ bataillon de cipayes de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Ambitieux, il se rendit à Delhi, où il entra en 1784 au service de Mahadji Sindhia, chef marathe influent. Chargé de former des régiments selon le modèle européen, il constitua une armée de près de 100 000 hommes, contribuant à l’hégémonie marathe en Inde du Nord. En récompense, Sindhia lui accorda des terres et des privilèges, lui permettant d’amasser une fortune considérable.
En 1796, de Boigne rentra en Europe. Il était né savoyard, il avait obtenu la nationalié britannique et se retrouvait maintenant français depuis l’occupation de 1792. Il s’installa d’abord en Angleterre, ensuite il revint à Chambéry et consacra sa richesse à des œuvres philanthropiques.
Les éléphants

Voilà donc pourquoi on trouve des éléphants à Chambéry. Le lien est l’Inde. Les quatre éléphants indiquent les quatre points cardinaux. Ils forment un plan en croix comme la croix de Savoie. La colonne qui soutient la statue est décorée de trophées militaires rappelant les campagnes auxquelles il a participé.
Cette statue fut érigée en 1838, sept ans après sa mort. C’est donc la plus ancienne des statues de Chambéry citées dans cet article, et la seule érigée pendant la période où Chambéry dépendait du Royaume de Sardaigne, avant l’annexion.
La ville était reconnaissante au Comte de Boigne pour toutes ses œuvres de charité et ses donations qui ont permis les transformations et la modernisation de la vile.
Il a financé la construction de l’hospice Saint-Benoît, destiné à l’accueil des personnes âgées. Il a initié le percement de la rue des Portiques, aujourd’hui rue de Boigne, pour moderniser le centre-ville. Celle qui relie la fontaine au château. Il a également financé la construction du Grand Théâtre, inauguré en 1824, et de la chapelle des Capucins. De plus, il a contribué à l’aménagement du faubourg de Montmélian et à l’embellissement de la façade de l’hôtel de ville.
Enfin les Chambériens peuvent se balader aujourd’hui dans son ancien domaine, le Parc de Buisson Rond, orné d’une magnifique roseraie qui jouxte son ancien château.
Le comte de Boigne a investi une part significative de sa richesse dans l’amélioration des infrastructures et le bien-être des habitants de Chambéry, laissant un héritage durable dans la ville.
Que voir d’autre à Chambéry ?

En quittant la statue par la belle rue à portique qui porte son nom en direction du château on revient dans le centre de la vieille ville médiévale.
La place Saint Léger aux façades étroites pour réduire la taxation sur les propriétés, les allées couvertes qui dessinent un labyrinthe dans le centre-ville, les ruelles étroites pavées et bordées de boutiques, les palais à l’architecture piémontaise, plus modernes, et le Carré Curial, ancienne caserne napoléonienne, devenue quartier général allemand et prison pendant la seconde guerre mondiale et lieu de détente et de fête pour les jeunes et les moins jeunes de nos jours, racontent l’histoire d’une ville qui a eu le privilège d’être pendant 268 ans la capitale d’un vaste Etat au cœur de l’Europe.
De cet Etat, il reste des édifices, quelques monuments, mais aucun témoignage statuaire des Comtes et Ducs de Savoie qui y ont vécu.
Cependant ce sont aussi de grands personnages qui ont fait l’histoire de la ville qui sont représentés dans toutes ces statues. Favre, homme de loi, Rousseau, philosophe, les frères de Maistre derniers grands personnages qui ont représenté la Savoie dans le Royaume de Sardaigne et au-delà, le Comte de Boigne qui a donné à Chambéry les fruits la fortune accumulée par-delà les mers et enfin le peuple personnifié par la Sasson, savoyarde devenue française.
Chacun a contribué à sa façon à l’histoire de Chambéry et de la Savoie. Lors de votre prochaine promenade dans la ville, ces personnages vous seront étonnamment familiers …
LIRE AUSSI : À Suse, les cinq accords qui ont marqué l’histoire des Alpes